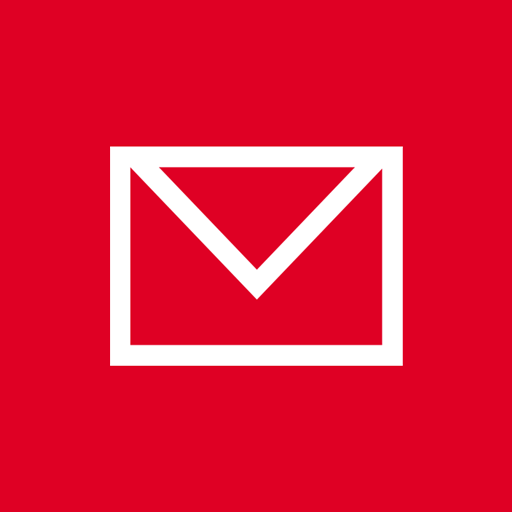Une bonne formation dans la participation citoyenne permet aux Comités Paroissiaux Justice et Paix de bien maîtriser les fondements et l’importance des parties prenantes, de relever leur rôle dans la promotion humaine, réfléchir et matérialiser sur le terrain les actions concrètes dans le cadre du Service Justice et Paix.
Face aux critiques sur la manière dont l’État, à travers ses représentants, conduit les affaires publiques, ou encore le manque d’accès aux services sociaux de base, les populations estiment qu’ils ne peuvent rien changer. Et cela du fait d’un manque d’intérêt et d’une incompréhension des enjeux et de l’importance de la question de la participation citoyenne au niveau social, politique, culturel et économique.
Le 27 juin 2020 à Yaoundé au Cameroun, la Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) de Yaoundé a tenu sa traditionnelle formation mensuelle dans sa salle de rencontre à Mvolyé dans le cadre du renforcement des capacités des Comités Paroissiaux Justice et Paix (CPJP) sur le thème « Le rôle du Service Justice et Paix dans la promotion de la participation citoyenne ».
Il en ressort que la notion de participation citoyenne révèle un sens plurivoque selon le contexte. Il s’agit donc : de gérer ensemble ; d’impliquer des communautés à tous les projets favorisant leur épanouissement ; de la contribution de chaque individu au bien de la société ; de mettre la main à la pâte pour que le pays soit mieux organisé mais aussi la contribution et l’implication des citoyens au développement local.
Cette notion se manifeste dans notre société à travers le vote, la construction d’un pont dans le village, être membre d’une commission, la construction d’un point d’eau dans une localité, un investissement humain, une aide accordée à une personne en détresse, une adhésion à une association.
Ce qui induit une implication, une contribution, un appel à la communauté dans la recherche du bien commun. La notion de participation citoyenne devient de ce fait une action posée par les populations avec l’Administration pour le bien commun dans le but de combler un écart et dont les fondements juridiques reposent sur la base de plusieurs axes que sont :
- La Déclaration Universelle des Droits de l’homme (1948),
- Le Pacte International pour les Droits Civils et Politiques (1966),
- La Constitution camerounaise dans son préambule qui reconnaît le devoir de chaque citoyen à participer à la gestion des affaires publiques.
Les objectifs de la participation citoyenne permettent ainsi au final de recueillir des avis et des objections, échanger des arguments, faire émerger des idées, prendre une décision et agir ensemble. D’où les degrés de participations suivantes :
- La coconstruction : il s’agit ici d’élaborer un projet de manière partagée. La définition, le développement et l’aboutissement du projet sont soumis aux discussions et sont évolutifs ;
- La concertation : il s’agit de construire un échange qui puisse ensuite modifier un projet. Ici c’est l’échange d’idées et d’arguments qui fonde les allers retours et la prise en compte des points de vue des participants ;
- La consultation : il s’agit d’entendre un avis sur un sujet donné. Les citoyens au sens large peuvent s’exprimer et la collectivité considère ensuite si elle prend en compte de manière effective ce qui ressort de l’échange ;
- L’information : il ne s’agit pas d’un dispositif participatif en tant que tel car l’information ne vise pas l’échange, mais elle constitue un préalable à tout dispositif participatif.
Le degré de participation revient dès lors à parler de degrés de responsabilité, donc de coresponsabilité signifiant que tous les acteurs, privés, publics et citoyens, sont responsables du progrès futur et du développement durable du bien-être de tous pour aujourd’hui et pour demain.
De ce fait, les conditions à remplir pour garantir la participation citoyenne à tous les niveaux sont :
- Vérifier que chaque partie prenante est prête à changer d’avis ;
- Délimiter le cadre de la concertation (objet, périmètre, acteurs, ce qui est négociable ou pas, processus de décision…) ;
- Garder un état d’esprit ouvert à la critique ;
- Veiller que le consensus puisse être recherché pour que le dissensus puisse s’exprimer ;
- Ne pas adopter une position de « sachant » ;
- Établir des règles du jeu précises et claires.
En ce qui concerne la Doctrine Sociale de l’Église, et en tant qu’enseignement de l’Église Catholique sur la vie sociale, la participation traduit une exigence de la socialité. Il est question pour chacun de prendre une part active à tout ce qui engage la communauté politique dont il est membre : la nation, la famille, l’État. Ce principe tire sa force dans le fait qu’il vise à assurer la réalisation des exigences de la justice sociale. Tout membre doit participer à la hauteur de ses forces de sa responsabilité, de sa situation sociale, politique et culturelle. La finalité est d’atteindre une nouvelle vie en commun qui soit humaine. Il touche donc les aspirations profondes de l’homme telle que sa dignité, sa liberté, son implication dans le progrès scientifique, technologique et dans la vie publique. Il est question de promouvoir l’émergence globale de soi-même et de tout son groupe social. Voilà pourquoi le principe de participation valorise l’esprit de fierté personnelle qui se reconnaît mieux dans une œuvre à laquelle on a pris part. Il est question d’éprouver de la gloire personnelle et commune au terme d’une participation, d’un engagement ardu et profond. Dans ce sens, le citoyen est intimement lié au destin de sa nation, ce qui l’élève, l’ennoblit de même que ses échecs l’attristent.
C’est pour cela qu’en Afrique, il est vivement souhaité de mettre sur pied des institutions capables de garantir le respect de la dignité humaine, la promotion du bien commun, la subsidiarité, le respect des droits de l’Homme en vue de la justice et de la paix sociale.
Il y a donc plusieurs solutions en ce qui concerne la redynamisation de nos communautés sur la participation citoyenne.
- Relever le rôle de Justice et Paix dans la promotion de la participation citoyenne
Il s’agit de :
- Décrire les injustices ;
- Former les personnes pour leur prise de conscience dans la participation citoyenne ;
- Informer et sensibiliser les communautés pour la participation et l’implication dans le développement local ;
- Éducation, et participation en tant qu’acteur.
- Proposer les stratégies pour promouvoir la participation citoyenne au niveau des CPJP
Il s’agit de :
- Faire des rencontres, des réunions, des concertations en vue de recueillir les avis des populations,
- Sensibiliser, former, informer et conscientiser ;
- Consulter et prendre les avis des autorités ;
- Concevoir des actions captivantes (hygiène et assainissement, aménagement des points d’eaux…) ;
- Faire du porte-à-porte et recenser les foyers.
- Proposer des actions concrètes pour relancer les dialogues populations-élus dans les paroisses.
Les préliminaires à ces actions sont :
- Les CPJP doivent être vivants ;
- Les CPJP doivent avoir des plans précis à court, à moyen et long-terme.
Et pour la relance des dialogues, il faut :
- Une bonne formation afin d’outiller les CPJP à pouvoir piloter les dialogues entre les populations et leurs représentants –locaux ;
- Recenser les besoins des populations par ordre de priorités ;
- Sensibiliser et intéresser les populations afin qu’ils participent au dialogue ;
- Mettre sur pied une bonne organisation zonale des CPJP pour coordonner les actions ;
- Communiquer au prône, par affichage, par téléphone, radios communautaires et les contacts directs ;
- Choisir les bons espaces et lieux de rencontres en prenant soins de bien planifier les jours, les thèmes et l’ordre du jour ;
- Mener un plaidoyer auprès des élus et bien les rassurer sur le bien-fondé des rencontres ;
- Rédiger les rapports de rencontres et les listes de présences.